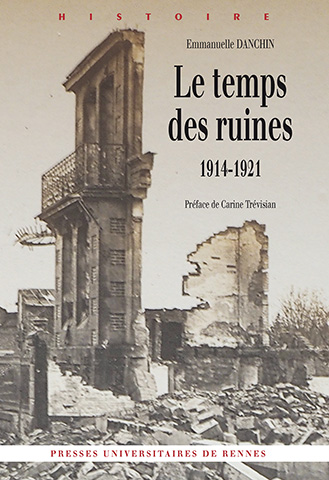 On doit aux commémorations du Centenaire de la Première Guerre mondiale une augmentation du nombre de publications consacrées à la Grande Guerre. Cependant, les publications traitant des conséquences matérielles de la guerre sur le paysage et le bâti sont rares, alors même que les destructions engendrées par le conflit ont été considérables.
On doit aux commémorations du Centenaire de la Première Guerre mondiale une augmentation du nombre de publications consacrées à la Grande Guerre. Cependant, les publications traitant des conséquences matérielles de la guerre sur le paysage et le bâti sont rares, alors même que les destructions engendrées par le conflit ont été considérables.
Chercheure-partenaire au SIRICE (Sorbonne-Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe), UMR 8138, Emmanuelle Danchin a publié Le temps des ruines (1914-1921) aux Presses universitaires de Rennes en 2015.
Nous lui avons posé quelques questions pour mieux connaître les matériaux qui ont nourri son beau travail historique. Ses réponses très fournies nous renseignent également sur le travail de documentation, d’évaluation, de sélection, d’analyse et de contextualisation des sources.
Quelle distinction faites-vous entre « ruine » et « ruine de guerre » ?
La « ruine » n’est pas une « ruine de guerre » et il faut opérer une distinction entre l’une et l’autre car les temporalités ne sont pas les mêmes et les représentations iconographiques qui en découlent non plus.
La « ruine », en effet, procède de l’usure du temps, elle est le fruit de la lente désagrégation des matériaux. Elle témoigne d’un passé et fait référence à une temporalité, celle du temps long. Il s’agit d’une ruine ornementale, envahie par la végétation qui nourrit l’esthétique, parfois réduite à un simple élément de décor. Ses représentations séduisent et laissent aller à la contemplation, à la rêverie, à la mélancolie.
La « ruine de guerre », par contre, est le résultat de l’éclatement brutal et soudain de la matière qui se fend, éclate, se broie et se tord. Elle témoigne du présent et induit une temporalité courte. Elle est le résultat d’une rupture nette et d’une violence exercée contre un bâtiment par l’homme, au moyen de l’artillerie ou d’explosifs. Elle se traduit par un recentrement sur la matière (la pierre, les structures en bois ou en fer), sur les gravats, sur les cassures visibles qui permettent de rendre compte de l’état de la structure d’un bâtiment ou plus largement d’un groupement d’habitations, d’édifices, d’installations industrielles ou agricoles.
Les témoins oculaires des dévastations matérielles de 1914, qu’ils soient reporters, soldats ou civils, ont été vivement touchés par ces ruines de guerre car la brutalité soudaine des destructions les a forcés à reconnaître la violence de la nature humaine. Ceux qui ont voulu immortaliser ces ravages par la photographie, par la peinture, par le dessin ou par le film étaient imprégnés d’une culture visuelle empreinte de la poétique des ruines du XVIIIe siècle et de la vision romantique des ruines du XIXe siècle. Consciemment ou non, ils ont donc parfois, dans leur cadrage ou dans la recomposition des éléments ruinés sur une toile ou sur une feuille de papier, reproduit certains poncifs de la ruine : esthétisation d’un paysage par le choix d’une lumière ou d’une couleur, par la mise en valeur d’une végétation renaissante ; ciel sombre accentuant le côté tragique de la scène ; plan d’eau laissant aller à la mélancolie ; absence d’êtres humains dans la scène soulignant davantage l’idée de désolation, etc…
D’autres, au contraire, s’en sont tenus au constat des destructions, usant alors des procédés classiques du cadrage (gros plan, plan moyen, plan d’ensemble), des angles de prise de vue (de face, de côté, en plongée ou contre-plongée) pour rendre compte des lieux traversés.
Dans le premier cas, les représentations suscitent l’émotion, une réaction, une prise de position face à ce qui est perçu comme une catastrophe ; dans le deuxième cas, les représentations documentent, enregistrent et inventorient les destructions.
Bien garder à l’esprit cette distinction permet à l’historien de regarder avec distance ces images de ruines produites pendant la guerre. Il ne transfère pas ainsi, comme l’ont fait parfois les contemporains de 1914, son ressenti et peut mieux appréhender, à l’appui parfois des légendes et des textes qui portent aussi ces images, les intentions contenues dans ces représentations.
Cette distinction permet aussi d’éviter de calquer sur les représentations de 1914-1918 (les peintures notamment) des idées valables pour celles des XVIIIe-XIXe siècles, mais qui nieraient les spécificités propres à la période de guerre. Elle évite également de s’en tenir à l’esthétique de la ruine ou à la sublimation. Elle permet, enfin, de s’interroger sur les continuités ou les ruptures dans les représentations de la ruine de guerre des conflits de 1870 et de 1912-1913.
En quoi a consisté votre travail de redéfinition des sources et comment avez-vous sélectionné vos sources ?
Pour amorcer ce travail sur les ruines de guerre, nous avons choisi de partir des représentations iconographiques et scripturales de la dévastation produites pendant le conflit. Pour ne pas nous enfermer dans le regard officiel, c’est-à-dire celui qui est alors offert au public (point de vue de la presse écrite, de l’armée, des artistes et intellectuels) et contourner l’écueil de la propagande, nous avons choisi de nous intéresser aussi aux regards officieux (ceux des soldats et des civils qui, par leurs photographies et leurs écrits, avaient aussi évoqué les dévastations). Maintenant, afin de ne pas nous en tenir à un regard purement français porté sur les dévastations françaises, nous avons aussi choisi d’inclure les regards portés par les belligérants anglais et allemands sur ces mêmes ruines de guerre.
Devant la masse de documents d’archives repérée, il a fallu ensuite opérer des choix. Après consultation, dans un premier temps, de ces documents en archives – première étape incontournable si l’on veut se rendre compte de la variété des représentations – il a fallu ensuite sélectionner parmi elles celles qui seraient retenues et étudiées. Le choix s’est alors porté sur ce que les contemporains de 1914 avaient « vu » de la destruction ou « eu entre les mains ». Nous avons donc retenu parmi les sources iconographiques : la presse illustrée, les affiches, les ouvrages illustrés, les cartes postales qui circulèrent en grand nombre, les films d’actualités, les albums photographiques de soldats, de civils et les vues réalisées par les opérateurs des armées, mises en albums et exposées, pour certaines dès 1916, dans le cadre d’expositions photographiques. Les peintures et les estampes, notamment celles des peintres missionnés aux armées et au ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, ont été consultées, mais pas entièrement exploitées. Seuls les films d’actualités montés et diffusés de la Section cinématographique des armées ont été sélectionnés.
S’y sont ajoutées les sources scripturales : la presse écrite, les carnets de guerre, les témoignages écrits et les versos de cartes postales de ruines qui livrent parfois des commentaires.
Le traitement de ces sources a été facilité par la réalisation d’une base de données qui, croisée à des statistiques sur les dévastations matérielles par département réalisées dans le cadre de notre DEA et croisée à la presse illustrée, ont fait apparaître une hiérarchie, selon l’intensité des dévastations, entre les départements du front et, à l’intérieur de ceux-ci, entre les communes et entre les types d’édifices. Nous avons alors choisi d’étudier plus particulièrement les départements qui avaient été les plus touchés par les dévastations, les communes et monuments très valorisés, mais aussi celles qui l’avaient été faiblement ; nous pensons, par exemple, aux villages rasés du canton de Charny autour de Verdun, pour lesquels la documentation est rare.
Maintenant, ces représentations n’ont été que le point de départ de ce travail permettant d’interroger la manière dont on avait voulu rendre présente la destruction et les discours que l’on avait portés dessus. La contextualisation des images de ruines de guerre nous a conduite vers d’autres archives. Nous nous sommes, par exemple, interrogée sur la destruction en tant que telle. Comment produit-on une ruine ? Les archives de l’armée de terre à Vincennes, les Archives nationales comme les archives départementales des départements retenus, nous ont éclairée tant sur les modes de destruction employés, les mesures mises en place localement, que sur les effets sur l’architecture, mais aussi dans les vies quotidienne et administrative.
De même, les débats qui surgissent dès 1915 autour de la valorisation des vestiges de guerre, nous ont dirigée vers les acteurs du développement touristique très présents dans ces débats, comme le Touring-club de France ou l’entreprise Michelin.
Enfin, les discussions souvent fructueuses avec les archivistes ouvrent aussi des pistes. Si nous n’étions pas allée travailler au musée de Cinquantenaire, à Bruxelles, nous n’aurions peut-être pas songé à nous rendre à l’Institut royal du patrimoine artistique, à deux pas de là, qui possède des collections relatives aux campagnes photographiques allemandes menées pendant la guerre pour enregistrer le patrimoine préservé de la zone occupée. Nous n’aurions du coup peut-être pas songé non plus à nous rendre à Metz afin de voir si ces campagnes photographiques avaient aussi eu lieu sur d’autres points du front.
En quoi les archives de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine ont-elles constitué un apport fondamental à votre travail ?
La Médiathèque de l’architecture et du patrimoine de Charenton-le-Pont abrite les archives du Service des Monuments historiques. On y trouve notamment les dossiers généraux sur les monuments historiques, en particulier les circulaires, les décisions et les instructions ministérielles, mais aussi les rapports et les notes sur l’administration du Service. Les documents sur le personnel des Beaux-Arts, ainsi que sur les mesures de défense passive y sont également conservés. On y découvre surtout des listes par département et par commune des édifices endommagés, des travaux de protection ou de l’évacuation des œuvres entreprise jusqu’à leur restitution. On y trouve, enfin, des archives relatives au fonctionnement du Service des monuments historiques durant la guerre (budgets et finances du Service) et relatives à l’évaluation des dommages de guerre.
Les archives de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine nous ont donc permis de comprendre les décisions de préservation mises en place dès le début de la guerre par le ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts pour les monuments classés du front et les collections, puis, la guerre se prolongeant, pour tous les autres monuments artistiques et religieux de la zone des armées.
Elles éclairent en outre les réflexions qui se firent jour dès 1915 autour de leur préservation et les débats à propos d’une valorisation des vestiges envisagée pour l’après-guerre. Elles montrent combien il fut difficile de sélectionner des monuments déjà en ruines, caractéristiques du conflit et de préserver des bâtiments appelés à terme à se disparaître.
Sans ces archives, ce travail se serait borné à une étude des représentations des ruines de guerre et des discours portés sur elles. Ces archives ont donc permis de comprendre comment le ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts avait envisagé les premières mesures de protection contre les tirs d’artillerie pour les édifices et collections situés dans la zone des combats. Elles ont aidé à reconstituer les débats qui émergèrent dès 1915 sur la conservation des ruines et sur la valorisation future des champs de bataille. Elles ont surtout éclairé la place occupée par le patrimoine architectural bombardé pendant la guerre.
La création d’une Section photographique et d’une section cinématographique de l’armée en 1915 est associée à la naissance des « images d’archives ». Pouvez-vous nous en dire plus ?
En 1915, la création d’une Section photographique (SPA) et d’une section cinématographique de l’armée (SCA) est le résultat de demandes conjointes des ministères des Affaires étrangères et de l’Instruction publique pour la constitution d’une documentation sur la guerre devant nourrir les archives, la propagande et l’histoire. Des opérateurs sont envoyés dans la zone des armées avec des instructions précises quant aux types de vues et de plans à réaliser.
À leur retour de mission, les plaques photographiques et les bandes nitrate des opérateurs étaient enregistrées, développées et remises au bureau de censure. Un exemplaire de chaque positif était ensuite mis en album afin de constituer « une mémoire visuelle des événements ». Trois militaires furent chargés en 1915 du titrage, du classement, de la traduction, du fichage et de la confection de ces albums, puis cinq en 1916, dix en 1917 et treize en 1918. 108 albums, soit plus de 18 000 photographies, furent confectionnés de 1915 à 1918. L’archivage se poursuivit après la guerre et la collection compta en définitive 559 albums.
Ces albums reprennent tous les aspects de la guerre – des opérations militaires à la vie du soldat, en passant par des séries sur la marine, les troupes coloniales, l’aide militaire et économique, jusqu’aux monuments et aux paysages dévastés du front ; d’où l’appellation « Pour la mémoire de la France » donnée à l’époque à cette série d’albums aujourd’hui conservés au Musée d’histoire contemporaine-Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (MHC-BDIC Paris) et à la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (Saint-Cyr / Montigny-le-Bretonneux).
Pour combler le manque d’images pour la période septembre 1914 – avril 1915, un appel fut lancé par voie de presse et de nombreux dons de particuliers furent recueillis puis intégrés aux albums. À ceux-ci, s’ajoutèrent les clichés du service des Beaux-arts, des documents d’avant-guerre (majoritairement des cartes postales), des collections transmises périodiquement par les services photographiques alliés, des documents iconographiques publiés dans les principaux périodiques illustrés des différentes nations, des documents typographiques de guerre publiés dans les journaux illustrés français
La volonté de constituer une documentation sur la guerre et notamment sur les régions dévastées, et d’en garder la trace par l’image, exista donc dès 1915, voire dès septembre 1914 si l’on prend en considération les reportages photographiques effectués pour le compte du service des Beaux-Arts. Comme au milieu du XIXe siècle, lorsque fut organisée la première Mission héliographique, la photographie fut perçue comme un instrument permettant de produire des fonds documentaires de manière fiable. Le cinéma fut, quant à lui, considéré comme un témoin oculaire véridique et infaillible.
Pourquoi avez-vous prolongé votre étude jusqu’en 1921 ?
Les premières représentations picturales et scripturales de ruines apparaissent dans la presse écrite et dans les albums amateurs de soldats dès le mois d’août 1914 ; notre travail commence donc naturellement avec le début de la guerre. Le choix d’achever cette étude en 1921 est venu des représentations elles-mêmes. Au-delà de cette date, en effet, les représentations de la dévastation changent et s’attachent désormais à mettre en avant la reconstruction et non plus la destruction. Cela se traduit par l’apparition de nouvelles représentations : soldats ou prisonniers déblayant les gravats, binant la terre ou fauchant les récoltes ; civils faisant leur marché au milieu des ruines ; maisons couvertes d’échafaudages, baraquements en bois ou maisons bien proprettes s’élevant au milieu des gravats. Ces vues montrent désormais le relèvement et non plus les décombres. Certes, des séries de cartes postales continuent de circuler, mais elles reprennent des vues déjà éditées pendant la guerre. Pour autant, les ruines matérielles restent bien physiquement présentes dans les régions dévastées et il faudra attendre parfois 10 ans pour que celles-ci s’effacent progressivement des paysages.
L’année 1921 correspond également à la fin de l’héroïsation des ruines. L’assimilation des ruines à des corps blessés, procédé de personnification qui permettait d’évoquer la souffrance des soldats pendant la guerre, s’estompe alors. La dénonciation des destructions se poursuit cependant localement bien après la signature du traité de Versailles.
Pas de commentaire